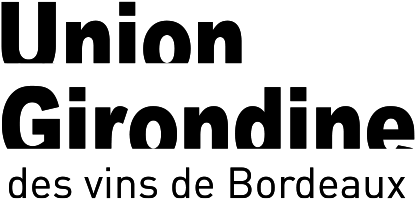La biodiversité, une alliée sur tous les fronts

La biodiversité ne se résume pas à la faune et la flore présentes au vignoble ! Ce sont aussi bien d’autres facettes, dont le forum a montré l’étendue des services qu’elles pouvaient apporter à la filière et à son adaptation.
Explorer la biodiversité des cépages
« La diversité de la vigne cultivée est extraordinaire», a lancé Olivier Yobrégat (IFV), en montrant l’étendue des dates de débourrement et de maturité (deux mois d’écart) de différents cépages, parmi les plus connus, issus de la grande collection de l’INRAE à Vassal. Pour le chercheur, les différences entre cépages de phénologie, de vigueur, de port, de fertilité et de rendement, de sensibilité aux maladies et ravageurs, de qualités… sont autant d’opportunités pour des adaptations en termes de changement climatique, de facilités culturales, mais aussi d’évolution des marchés et des goûts, et même de marketing.
D’où l’importance des travaux de recherche et de conservation des cépages, de leur diversité variétale et clonale, assurés par de multiples organismes. Les cépages « patrimoniaux » sont une piste intéressante d’adaptation. En Gironde, Le CIVB a financé un travail de prospection mené en 2023 et 2024 : 63 cépages et 20 variétés ont été retrouvés. La plantation d’un conservatoire au Lycée agricole de Blanquefort est prévue en 2025-2026. « Nous avons sélectionné les cépages les plus qualitatifs permettant de proposer des choses intéressantes à la viticulture », a indiqué Ronand Jehanno (Chambre d’agriculture de la Gironde).
S’adapter grâce à la diversité des cépages
Pour Kees Van Leeuwen (Bordeaux Sciences Agro), l’adaptation au changement climatique est un défi majeur et le choix du matériel végétal un levier essentiel, que ce soit par la variété clonale, la modification des proportions de cépages ou l’introduction de VIFA (variétés à fin d’adaptation). « Le vignoble de Bordeaux a beaucoup d’atouts : un climat tempéré avec peu d’excès, une identité forte grâce à nos AOC, une faible empreinte « eau » dans la production de vin et un encépagement diversifié et évolutif. Pour vendre du vin, deux approches possibles : soit avec une identité régionale, comme à Bordeaux, soit avec une mise en avant du cépage. Contrairement à l’identité régionale, peu importe que le cépage soit adapté au contexte climatique pour un vin de cépage. Cela amène par exemple à planter du Chardonnay dans des régions chaudes et sèches, ce qui est un non-sens agronomique et oblige à utiliser beaucoup plus d’intrants. »
Le chercheur préconise avant tout un encépagement adapté au régime thermique du vignoble, soulignant que, peu à peu, avec le changement climatique, le Sauvignon blanc et le Merlot sont en train de quitter la fenêtre optimale de maturité, entre la mi-septembre et la mi-octobre. « Le vignoble de Bordeaux est dominé par le Merlot, cépage précoce, vulnérable aux fortes températures, sensible à la sécheresse et au mildiou, a rappelé le chercheur. Il ne faut pas l’abandonner, il reste important dans l’encépagement de Bordeaux, mais on peut simplement en diminuer la proportion au profit du Cabernet-Sauvignon et du Cabernet Franc. »
Il y a aussi, pour lui, une carte à jouer avec le Malbec, le Petit Verdot et dans une moindre mesure le Carménère, qui produit des vins au pH très élevé. Et puis, pour les vins blancs, Kees Van Leeuwen pense que le Colombard est un cépage à reconsidérer, produisant des vins avec une typicité aromatique proche du Sauvignon blanc, avec plus d’acidité.
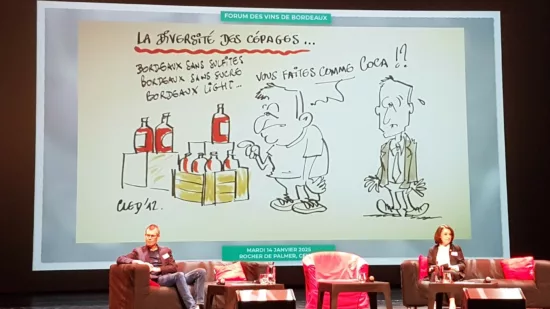
Communiquer sur une empreinte vertueuse
« Le vignoble de Bordeaux a évolué de tout temps et finalement, ce n’est pas anachronique d’introduire de nouveau quelques cépages secondaires », juge le chercheur. Il a également préconisé de communiquer vis-à-vis du consommateur sur l’empreinte « eau » très vertueuse à Bordeaux, en l’absence d’irrigation. « D’autres pays ne s’en privent pas ! Au Chili, par exemple, les rares domaines qui n’irriguent pas le mettent en avant sur leurs étiquettes. »
Explorer la biodiversité dans les vins
Si la biodiversité apporte des services écosystémiques au vignoble, c’est aussi le cas de la biodiversité des micro-organismes dans le chai, et surtout celle qui va se développer dans le moût, dans le vin en cours de production. « L’étude de cette biodiversité est essentielle pour produire des connaissances qui vont aider à trouver des nouvelles solutions : des outils de gestion de fermentation, de maîtrise des altérations microbiennes. C’est d’autant plus important aujourd’hui que les micro-organismes évoluent avec le changement climatique, avec les changements de pratiques », a souligné Patrick Lucas (Université de Bordeaux, ISVV).
Le travail des chercheurs consiste à étudier la biodiversité à différentes échelles, au niveau de l’espèce et des souches elles-mêmes. Après collecte des micro-organismes dans les exploitations ou les congélateurs des laboratoires, ils tentent d’appréhender leur diversité, de les classer, afin de déterminer ensuite leurs propriétés d’intérêt, leurs capacités fermentaires, leurs capacités à produire des composés d’impact sensoriel, leurs actions en termes de bioprotection etc. lorsqu’ils sont utilisés seuls ou en mélange. « Au chai, vous n’allez pas uniquement utiliser les micro-organismes de la nature, vous allez aussi produire des micro-organismes nouveaux. Vous domestiquez des micro-organismes sauvages qui s’adaptent au type de vin que vous produisez », précise le chercheur.
Ces connaissances permettent de développer des solutions : sélection de souches fermentaires, de bioprotection, pour acidifier, ou encore de tests d’analyse pour les détecter. Parmi les exemples récents cités par Patrick Lucas, la sélection de souches commerciales adaptées au type de vins ciblés qui utilise notamment des données génétiques ; la mise en place de protocoles de pied de cuve pour mieux gérer et fiabiliser les fermentations malolactiques (disponibles sur le site des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine) ou encore le développement de tests permettant de détecter en amont la présence de certains micro-organismes pour maîtriser voire éviter les altérations du vin (goût de souris, amertume).
Des armes pour lutter contre les Bretts
Isabelle Masneuf Pomarède (Bordeaux Sciences Agro) a livré quelques résultats en particulier de 10 ans de travaux sur Brettanomyces bruxellensis, principale espèce responsable de l’altération des vins rouges. « Nous avons montré que toutes les souches de B. bruxellensis produisent des phénols volatils, c’est vraiment une signature de l’espèce. Cette production est fortement associée avec la croissance. Nous avons également montré que l’efficacité du chitosane dépend de la souche. La bonne nouvelle, c’est que les souches qui sont tolérantes aux sulfites sont sensibles au chitosane, ce qui veut dire que nous avons encore des armes pour lutter contre les Bretts. Toutes les souches sont également sensibles aux UVC et à la lumière pulsée, deux stratégies prometteuses dans l’avenir pour traiter les surfaces ou traiter les vins dans le cas de contamination. » L’ensemble de ces résultats a conduit à la mise au point d’un test moléculaire, avec brevet déposé, pour détecter les souches selon leur comportement vis-à-vis des sulfites (tolérantes ou sensibles), et ainsi formuler des recommandations plus précises sur la prévention de la contamination et le traitement des vins.
La chercheuse a également rappelé la création, en 2023, à l’initiative de l’UMR Œnologie, d’un Observatoire de la biodiversité des micro-organismes œnologiques qui a pour ambition de produire de nombreux résultats. Les premiers sujets d’études : l’impact du climat sur le microbiote de la baie de raisins à maturité, l’impact des pratiques (pratique de levurage vs utilisation de pied de cuve ou fermentation spontanée), l’émergence de micro-organismes d’altération…
Au cours de la matinée, Brice Giffard (Bordeaux Sciences Agro) a brossé le portrait de la biodiversité des sols : composition, fonctionnement, rôles… Coralie Petiqueux (Vitinnov) a pour sa part rappelé les services systématiques rendus par la biodiversité au vignoble, puis les grands principes pour la favoriser, que ce soit à l’échelle de la parcelle (couverts…) ou de l’exploitation (fauches tardives, haies, mares…), invitant au préalable à réaliser un diagnostic des infrastructures agroécologiques de son exploitation.

> Cécile Poursac et Claire Thibault
En France, la préservation de la biodiversité arrive en tête des motivations des acheteurs de vins bio et de vins nature, devant leur santé ou la recherche d’une meilleure qualité ou d’un meilleur goût du vin, selon l’étude des tendances de consommation présentée par Ann-Cécile Delavallade, directrice du Service Économie et Études du CIVB.
Un Français sur 2 regarde d’ailleurs si une certification environnementale est présente sur une bouteille avant de l’acheter, et particulièrement les 26-35 ans. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les acheteurs de vins alternatifs (vin bio, nature, fair trade, sans sulfites, biodynamique) sont majoritairement achetés par deux générations : les GenZ (15-30 ans) et les Millénials (30-45 ans). « Il est donc indispensable d’afficher les certifications environnementales sur les bouteilles de vins. Parmi ces certifications, le label bio est très connu des consommateurs français. »
L’étude relève toutefois une dissonance cognitive, à savoir que cet intérêt ne se convertit pas forcément en achat. Parmi les explications, le prix reste en France un facteur important, dans un contexte économique sous tension, avec une inflation qui a marqué les esprits depuis 2022.