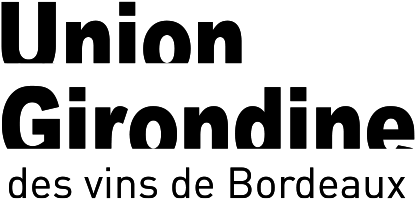Laurent Cassy : « Il nous faut bâtir un modèle que l’on peut transmettre »
Laurent Cassy a été élu vigneron de l’année par Terres de Vins lors de la remise des Trophées Bordeaux Vignoble engagé. Président des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, membre du syndicat des Bordeaux, Laurent Cassy a le goût de l’expérimentation et de l’échange. Vigneron conventionnel, puis en bio, et depuis cette année certifié en biodynamie, il avance guidé par deux passions : la vigne et le lien humain.
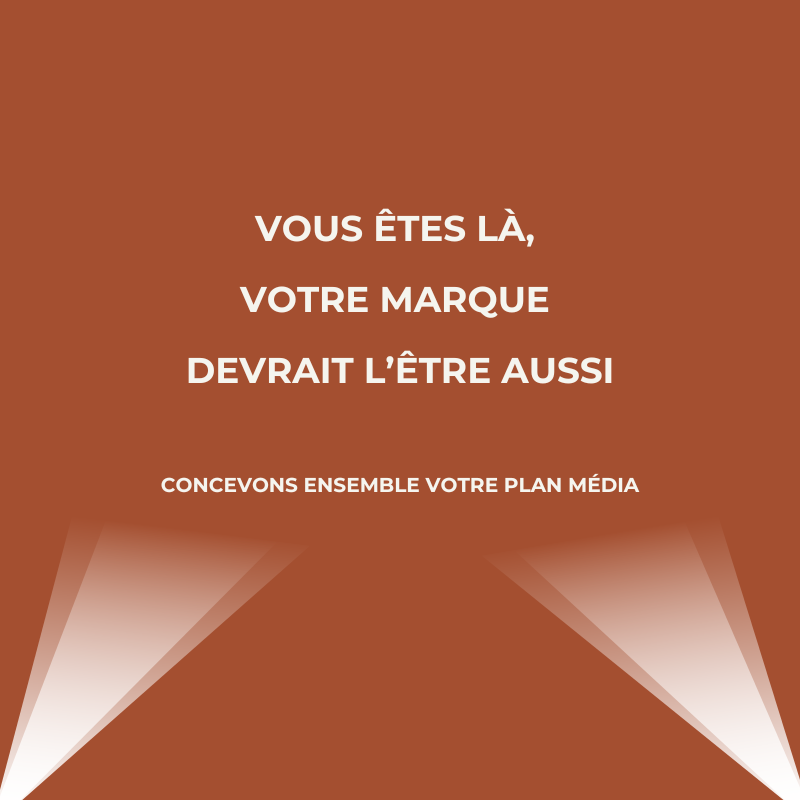
Laurent Cassy circule dans ses vignes de Morizes. L’homme en impose par sa carrure, une force de la nature souriante. Ses mains sont celles d’un homme de la terre qui n’a pas peur du travail. Quand il s’exprime, son ton est pondéré, mesuré. Et ses yeux brillent de curiosité et d’émerveillement du monde qui l’entoure. Rencontre avec un vigneron placide, réfléchi et investi.
Laurent Cassy, vous êtes vigneron à Morizes. Vous avez été élu Vigneron de l’année par Terres de Vins à l’occasion des Trophées Bordeaux vignoble engagé. Comment avez-vous apprécié cette distinction ?
Cela a été une vraie surprise. Depuis trois ans, je participe à cette manifestation. Chaque année, j’essaye de concourir dans une catégorie différente. Je me dis que c’est une façon de porter une parole de vigneron. Mais cela vient saluer un travail d’équipe, de la famille, des salariés.
À travers ce prix, on parle aussi pour tous les gens silencieux. Il y a beaucoup de gens à la vigne qui font des efforts, qui ne sont pas entendus, qui sont parfois stigmatisés et c’est dommage. La majorité des vignerons à Bordeaux a engagé des démarches, s’est remise en question, sans bruit. L’humilité, je pense que c’est ce qui qualifie la viticulture bordelaise.
Vous êtes président des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, vous n’êtes pas tombé dans le bio tout petit.
Comme j’arrive du conventionnel, je suis un atypique. Je suis né en 1970 et j’ai repris l’exploitation familiale en 1993. J’avais obtenu un BTAO avec option œnologie. J’étais le dernier de la fratrie, et confronté à la reprise de l’exploitation. Mon père était en conventionnel mais avait des affinités avec l’agriculture biologique.
J’ai toujours été attiré par la compréhension, les expériences. J’ai toujours été attiré par le questionnement, l’éventualité de faire changer les choses.
Assez vite, j’ai participé à une expérience avec l’ISVV. J’avais entendu parler d’Optidose. Je cultivais à l’époque des rangs témoins avec plus ou moins de traitement. Ils m’ont dit : « Vous allez plus loin que ce que l’on préconise, cela nous intéresse. On va vous suivre ! »
À cette époque, je trouvais bizarre d’acheter des produits avec des pictogrammes à tête de mort. Des produits que l’on nous vendait avec le sourire. Et c’est ainsi que nous avons participé à une étude sur les expositions aux produits phytosanitaires avec l’université de pharmacie. Tous, sur l’exploitation, avons participé au protocole. Nous avions des patchs sur la peau, on devait réaliser des analyses d’urine. Le tout était analysé par quatre laboratoires indépendants. C’est à la suite de cette étude qu’ont été mis en place les délais de ré-entrée en parcelle après traitement.
Qu’est-ce que vous avez retenu de cette expérience ?
Nous constations que certains se contaminaient à la préparation, d’autres à la pulvérisation, voire au nettoyage du pulvérisateur. Cette étude a permis de réglementer les délais de ré-entrée, a imposé les équipements de protection individuelle (EPI).
À la même époque, mon père a déclenché la maladie de Parkinson. On peut supposer que cela était lié aux expositions. On s’est retrouvés confrontés à la mort et on s’est dit : il faut changer.
C’est ainsi que vous intégrez le SME de Bordeaux ?
Ce que je souhaitais, c’était de voir ce qui était intéressant avec les différents cahiers des charges. Et en quoi ils peuvent m’aider à vendre mon vin. La Haute Valeur Environnementale n’est pas une finalité, mais un accompagnement vers la vertu.
Mais votre curiosité vous a poussé à aller plus loin, non ?
C’est au moment des soucis de santé de mon père que nous nous sommes engagés vers le bio. Non que le bio soit le graal, mais c’est une façon d’évoluer et de comprendre. Puis nous avons évolué en biodynamie, avec une certification Demeter en 2019
Et êtes-vous rassasié dans votre appétit de connaissances ?
Aujourd’hui, je pense que l’on peut faire plus. Chez moi, cela passe par l’embauche d’un salarié sur l’évolution des pratiques. Avec le temps, on constate, mais il n’y a pas de vérité. Ce qui nous a plu dans la biodynamie, c’est l’échange des pratiques. Cela remet du lien humain. Je crois qu’après guerre, la chimie avait isolé les agriculteurs. Là, on remet du lien humain. La biodynamie impose de se voir, d’échanger. J’ai toujours été dans la notion du partage. J’ai été trésorier puis président d’une CUMA et conseiller municipal de Morizes. Je constate que c’est toujours difficile de se tromper, et plus encore de le dire. Beaucoup ont peur de parler de leurs erreurs. Pourtant, c’est un moteur d’évolution. Avant la chimie, les anciens notaient les choses, écrivaient beaucoup. Après la guerre, la chimie a offert du confort, de la facilité, c’est comme cela qu’elle a été abordée.
Vous semblez être en permanence à cheval entre deux générations, vous y pensez souvent ?
Il faut toujours situer la place de l’agriculture dans le monde. Mon père est né en 1927. Quand il a repris l’exploitation familiale dans les années cinquante, on lui disait : « Pour le prix d’une paire de bœufs, vous avez un tracteur. » Regar- dons les choses aujourd’hui. Un tracteur coûte entre 50 000 et 100 000 €. Une paire de bœufs s’échange au prix d’un smartphone… On voit le fossé qui s’est creusé entre la paire de bœuf et le tracteur. Quand on voit le poids de l’alimentation dans les achats des ménages, et qu’il est proche du budget téléphonie et loisirs digitaux, cela pose question. Au final, l’agriculture ne pèse même pas 3 % de la population active…
Comment envisagez-vous cette agriculture de demain ?
Ce n’est pas une question personnelle, c’est une question de société : est-ce que les Français veulent toujours d’une agriculture ? Sur le terrain, ce que nous observons, c’est de moins en moins d’agriculteurs et de viticulteurs. Mes arrières-arrières grands-parents vivaient sur 1,67 hectare. Mon père a débuté avec 5 hectares. Moi avec 19 hectares, et nous cultivons aujourd’hui 55 hectares. Nous nous sommes agrandis parce que les voisins s’arrêtaient et n’avaient pas de successeurs. Il y a 15 ans, les jeunes se battaient pour avoir de la vigne. Aujourd’hui, nous avons des vignes dont personne ne veut. Donc ne donnons pas de leçon. Restons humbles et échangeons. Tout l’enjeu est de bâtir un modèle que l’on peut transmettre. Mais si on veut redonner de l’espoir aux vignerons et aux jeunes, il faut retrouver de la marge.
" Si l’on veut redonner de l’espoir aux vignerons et aux jeunes, il faut retrouver de la marge "
Vous parlez des vignerons bio ?
Non, je parle de Bordeaux. Nous devons nous poser la question de la monoculture et de la diversification. Réfléchir aux contraintes sociétales.
Ici, à Morizes, c’était la polyculture et l’élevage. Et la culture du tabac offrait de la valorisation aux exploitations. Cette culture a disparu. Avec la tendance hygiéniste, si demain on nous dit : « Il ne faut plus boire d’alcool », que ferons-nous ?
Nous exerçons une activité qui nous demande de faire vingt métiers en un. L’État a compris qu’en nous donnant du travail administratif, il laissait du temps aux fonctionnaires pour nous contrôler, et les contrôles sont permanents. Nous faisons face à une météo capricieuse. Autrefois, vous aviez un coup de gel tous les 15 ans, un épisode de grêle tous les 15 ans. Aujourd’hui, sur cinq ans, vous avez trois aléas climatiques et une année à zéro. Si on ne peut intégrer sur cinq ans une année perdue, on est mort. On peut se retrouver du jour au lendemain sans revenu.
Vous parlez de retrouver de la marge. Cela passe par quelles orientations ?
Pour moi, le concurrent, ce n’est pas le Bordelais ! Si je considère le Bordelais comme mon concurrent, alors cela tire les prix vers le bas. Des bouteilles à 2,50 €, ça ne fait rêver personne. Je pense que nous ne sommes pas assez dans l’envie de travailler ensemble. Aujourd’hui, les viticulteurs évoluent. Et l’on sent que beaucoup de négociants ont aussi envie d’évoluer.
Vous êtes président des Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine (VBNA), comment abordez-vous cette responsabilité ?
Il y a un dynamisme très intéressant, avec beaucoup de dialogue. Toutes les personnes qui veulent aller vers des pratiques vertueuses sont les bienvenues, en laissant les querelles de clocher de côté. Notre enjeu est d’essayer d’avancer, et de le faire ensemble pour trouver des solutions.
Ce qui est intéressant est que les anciens et les nouveaux échangent. Ce qui fait la force du bio est d’être un modèle qui se plaît à penser : « Si on nous propose un prix trop bas, on ne vend pas ! ».
Cet afflux de viticulteurs bio ne risque- t-il pas de faire baisser les prix ?
Aujourd’hui, le vin bio se vend. Mais demain, il sera toujours plus facile de vendre du vin bio que du vin conventionnel. Ce qui me préoccupe, c’est le bas prix du conventionnel, car cela tire tout le monde vers le bas. En même temps, une certification environnementale, c’est s’imposer de ne pas décevoir un client. C’est ce que nous demande le consommateur bio.
Vous voyez donc le bio comme une solution d’avenir ?
Notre impératif, c’est de donner envie aux jeunes, qu’ils soient salariés ou viticulteurs. Et aujourd’hui, le bio redonne envie. Mais le bio impose de l’accompagnement. Entre 2008 et 2012, on a observé un phénomène de déconversion, lié à des pertes de récolte, à des difficultés de main-d’œuvre. Aussi, à VNBA, nous avons participé à la mise en œuvre d’un réseau de conseillers pour réussir cette conversion.
Malgré les difficultés, et au sortir de deux années difficiles, vous semblez garder la passion.
Bien sûr que nous exerçons un métier de passion. Et il faut le faire connaître pour que d’autres passionnés reprennent le flambeau. Il faut que l’on montre aussi que c’est un métier dans lequel on peut se faire plaisir. Nous sommes dans la jonction entre comprendre ce que faisaient nos ancêtres et apporter notre patte à notre époque. Et l’on peut s’amuser avec tout cela. Il faut garder à l’esprit qu’il est plus facile de se plaindre que d’avoir le sourire. Mais nous ne donnerons envie qu’avec le sourire !
Propos recueillis par Emmanuel Danielou