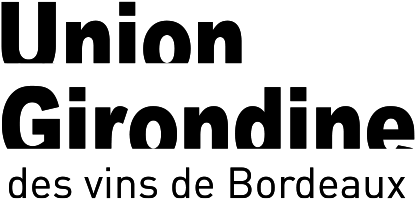« La crise n’a pas bouleversé les tendances, elle a joué le rôle d’accélérateur »
Jean-Marie Cardebat est économiste, professeur à l’Université de Bor-deaux et à l’Inseec, auteur de « l’Économie du Vin » (La Découverte), et président de l’association européenne des économistes du vin. Durant Vinitech, il a présenté une recherche européenne sur l’impact du Coronavirus sur l’économie du vin. Au-delà de la situation actuelle tendue, source de bouleversements et d’adaptations, il plaide pour un marché à terme du vrac à Bordeaux.
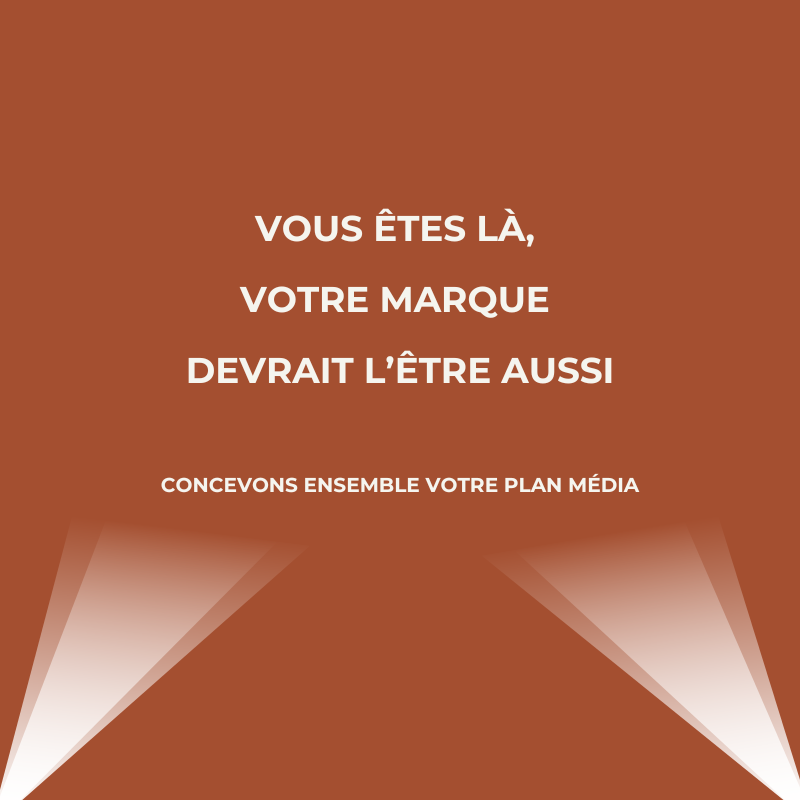
Jean-Marie Cardebat est professeur d’économie à l’Université de Bordeaux et à l’Inseec, directeur du laboratoire d’analyse et de recherche en économie internationale (Larefi), président de l’association euro- péenne des économistes du vin (EuAWE), et dirige la chaire Inseec Vins et Spiritueux. Le 17 novembre, lors des Vinitiques (Inno- vin), il faisait un point sur « les nouveaux modes de consommation ». Le soir, il intervenait dans le cadre des Vendanges du Savoir sur le thème « La guerre commerciale coulera-t-elle l’industrie française du vin ? ».
Enfin, il participait à deux débats pendant Vinitech : « Faut-il inventer de nouvelles pratiques commerciales à Bordeaux » et « La filière vin après le Coronavirus » (les quatre interventions sont accessibles en replay).
Jean-Marie Cardebat, vous êtes président de l’association européenne des économistes du vin (EuAWE). Vous venez de livrer de livrer une étude sur la filière vin après le Coronavirus. Quelles observations en retirez-vous ?
Il n’y a hélas pas de message miracle à envoyer. La filière vin a beaucoup souffert, notamment à l’export. C’est le cas du Bordelais, très fortement aussi de la Champagne. La logistique s’est quasiment arrêté lors du premier confinement. Cela fait beaucoup de ventes perdues. Beaucoup de manifestations ont été annulées. Cela a débuté par le Nouvel An chinois, Or c’est un moment de consommation de vins, notamment bordelais.
À l’échelle française, nous avons observé un déstockage assez massif des vins en cœur de gamme et premium. Les Français qui boivent du vin, souvent ont des caves. Je parle là d’un placard avec une vingtaine de bouteilles comme d’une « vraie » cave. Et cela a été bu, c’est ce qui ressort de notre enquête.
À la même période, les ventes se sont faites sur l’entrée de gamme. Le réassort s’est fait au moins cher, le premium a été consommé par le déstockage domestique.
Dans la phase de distribution, plusieurs canaux se sont retrouvés à l’arrêt (CHR, sa- lons). Avez-vous observé une modification des modes d’achat ?
Le canal de la CHR était très perturbé, l’œnotourisme n’était plus possible, les salons étaient annulés. Pour autant, il devenait impératif de toucher le consommateur final par d’autres moyens. Le leitmotiv qui semble s’avancer pour 2021, c’est le DtoC, Direct to Consumer. C’est de l’e-commerce internalisé à l’échelle de la propriété. La croissance est là.
Le vin a vocation à se vendre sur le web. Cette crise est un accélérateur de tendance. Elle n’a pas bouleversé les tendances sur les terroirs, sur le bio, cela existait avant. Cette crise n’est pas disruptive (qui rompt avec l’existant), mais elle fortement accélératrice sur certains aspects. Au-delà même de l’e-commerce, c’est comment toucher direc- tement le consommateur.
Dans vos interventions, vous pointez du doigt une montée en puissance du local. Où place-t-on le curseur du local ?
Le local est une notion qui n’est pas que géographique. Je préfère parler de proximité. La proximité peut être culturelle, de valeur, historique, on peut être sensible à un discours, à une démarche. On peut être au fond du Connemara et être sensible au mode de production d’un vigneron de Cahors ou de Bourg qui a sa façon de produire du Malbec.
Le haut de gamme a déjà engagé cette notion de proximité en créant des effets de clubs, d’ambassadeurs. C’est ce qui est recherché aujourd’hui, et qui fonctionne sur le plan marketing. La notion de proximité a toute sa place à l’export.
" Bordeaux a vocation à être la capitale financière du vin "
Dans cette notion de proximité, un label environnemental est-il devenu un atout marketing ?
Ah oui, clairement. Il y a une tendance sociétale qui dépasse largement le vin. Le secteur du bio a une croissance de 10 à 20 % par an, et pas qu’en France. C’est un argument marketing énorme au- jourd’hui, incontournable. Le Bordelais a été très lent à communiquer sur ce qui était fait et à faire. Aujourd’hui, il le paye. Son image s’est considérablement ternie. Et stratégiquement, cette question aurait dû être prise à bras-le-corps voici 10 ans, tant on sentait venir cette montée en puissance.
D’autres ont fait des erreurs stratégiques. Je pense au patron de Général Motors qui ricanait de Toyota et de sa Prius, on connaît la suite de l’histoire... Cette tendance sociétale, elle est là, qu’on le veuille ou non.
Vous semblez très critique sur la stratégie environnementale de Bordeaux ?
Je prends la précaution oratoire de distinguer communiquer et faire. Faire, le Bordelais continue à progresser. Sur la question des herbicides par exemple, de mon point de vue, ils sont même plutôt en avance. Mais les éléments de communication sur le bio n’ont pas forcément été maîtrisés.
Au regard des crises passées et celle du Covid 19, comment analysez vous la suite des événements ?
L’histoire est têtue, elle aime à se répéter. Après chaque crise économique, on a des changements de paradigmes sociétaux, économiques et politiques. On observe une montée en puissance des populismes depuis la crise des subprimes en 2008. Je pense fondamentalement que la relance économique pourra se faire vers une « green » économie. Aujourd’hui, la réduction des impacts environnementaux va guider l’économie. Ce sera l’énergie verte, les bâtiments, les voitures. Tout va être verdi quel que soit le business que l’on fait, et le vin en fait partie. Il est là le moteur de croissance des 20 ou 30 prochaines années,
Vous portez depuis longtemps l’idée, à Bordeaux, d’une marque forte, idéalement verdie. Est-ce le moment de l’engager ?
Ah oui ! Cela devient urgent car tout le monde ne peut pas s’installer sur le segment premium. Mais cela suppose en amont une organisation du marché un peu différente. Aujourd’hui, le système des grands faiseurs et des caves coopératives peine à dégager une marque très forte en entrée de gamme qui soit compétitive et rémunératrice pour l’ensemble de la filière.
Sur l’entrée de gamme, on peut gagner beaucoup d’argent contrairement aux idées reçues. Gardons à l’esprit qu’aujourd’hui, Dacia est plus rentable que Renault.
Une marque consisterait en un produit sans défaut, qui serait un repère dans la production de la diversité ?
Le principe d’une marque est une stabilité de la qualité. Sur une entrée de gamme, rien n’oblige à la mention du millésime. Pourquoi faire un rouge à Bordeaux qui soit millésimé ? La loi ne l’oblige pas. Puisque nous sommes des assembleurs à Bordeaux, assemblons !
Une marque Bordeaux nécessite au- tour de la table caves coopératives et négociants pour convenir d’un produit qui puisse être marketé ?
Je crois aux solutions de marché qui ap- portent de la transparence. C’est cela le marché. Et nous souffrons du manque de transparence. La création d’un marché à terme pour le vrac, c’est-à-dire est un marché organisé, avec un système de chambre de compensation, comme il en existe sur le blé, le café, le sucre, ou même le jus d’orange aux États-Unis. Où vous pouvez acheter le produit, pour une quantité donnée, une valeur donnée, à une échéance donnée (3, 6, 12 mois). Et quand c’est engagé, c’est inscrit dans le marbre. Cela permettrait de beaucoup mieux gérer le risque climatique (de sur ou sous récolte), et de sécuriser les approvisionnements. Une marque suppose un goût constant, mais surtout, il faut qu’elle soit présente sur les rayons. Et il n’y a rien de pire pour une marque que d’être absente des rayons.
Dans la pratique, comment cela fonctionne ? Comme la bourse ?
C’est de la bourse, comme un marché boursier. Un marché à terme engage un échange physique de marchandise (comme un marché au cadran dans d’autres secteurs d’activité) et un marché papier (où spéculent des banquiers, des risqueurs). Tous les secteurs alimentaires utilisent cet outil, sauf le vin. Pour le vendeur, c’est un système de primeurs, et cela sécurise ses ventes. Ce type de marché viserait à pacifier les relations entre viticulteurs et négociants.
Une marque, à l’autre bout de la chaîne, chez l’acheteur, l’importateur, ce sont des volumes et des prix stables. Dans cet esprit, les courtiers peuvent aussi se réinventer en « market maker ».
Vous croyez qu’un tel marché à terme, consacré au vin peut aujourd’hui émerger ?
J’étais en février dernier à Sacramento lors d’un salon important aux États-Unis. Les deux plus grosses sociétés de négoce de vrac réfléchissent à un marché à terme. Si on se retrouve en retard, demain, nous irons nous faire coter sur le marché américain.
Si on vous écoute avec attention, le premier pays qui va mettre en place un mar- ché à terme sur le vin, deviendra de facto, capitale mondiale économique du vin ?
C’est ce que je pense. Regardez sur les vins fins, aujourd’hui, la capitale financière est Londres. Pour le vrac, il serait dommage que ce soit une ville américaine qui s’en empare.
Bordeaux a vocation à devenir la capitale financière du vin, à la fois sur les vins fins et aussi sur les vins d’entrée de gamme (cotations des lots par cépage : en cabernet, en merlot, mais aussi d’autres grands cépages non présents à Bordeaux). Et là, Bordeaux peut s’imposer !
Ces réflexions, nous les abordons dans le cadre de la chaire Inseec Vins et spiritueux à Bordeaux qui propose une autre réflexion collective à la filière.
> Propos recueillis par Emmanuel Danielou